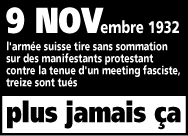à la mémoire du 9 novembre 1932, pour la démocratie et la liberté
p.a. CGAS - Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève
le syndicalisme a ses limites, mais…
toujours nécessaire pour aller au delà
Contribution pour la plaquette (téléchargeable ici) éditée par le comité du 9 novembre à l’occasion de du 60e anniversaire, et repris dans l’ouvrage publié en 1992 par le GSsA intitulé « 60 ans après la fusillade du 9 novembre à Genève »
Les nécessités des luttes d’hier ressemblent à celles d’aujourd’hui. Pourtant nos anciens racontent que l’on savait mieux alors trouver entre nous ce qui unit et que maintenant, lorsque l’on « fait » ensemble, trop souvent certains mettent en avant ce qui nous divise.
Oui, le travail n’est plus le même en 1992, il a changé et les travailleurs aussi. Les effectifs de la classe ouvrière ont diminué depuis 1932 et pendant cette période un grand nombre de postes de travail ont été créés dans les services. Depuis 10 ans, la création des nouveaux emplois n’a plus majoritairement pour fonction d’économiser du temps de travail et d’augmenter la productivité générale de la société, mais plutôt de gaspiller de l’énergie et des forces humaines pour la satisfaction et le plaisir de ceux qui ont de l’argent à dépenser.
Le syndicalisme continue à avoir sa raison d’être et rappelons qu’il est l’organisation de ceux qui sont contraints de vendre leur force de travail et qui se regroupent pour obtenir des moyens de subsistance au meilleur prix possible. Pour beaucoup, il s’agit d’amener les employeurs à restituer une partie des valeurs produites. Le travail étant la principale marchandise, celle qui permet de créer toutes les autres, le principal moyen d’action des travailleurs organisés restent encore celui d’en restreindre opportunément l’usage. Ainsi la grève peut contribuer au règlement des conditions d’exploitation du moment et du lieu, et la lutte peut alléger temporairement le joug du salariat.
se défendre…
Il y a nécessité de résister aux sous-enchères des employeurs en matière de conditions de travail puisque paradoxalement plus les travailleurs produisent, plus ils diminuent le coût de leur entretien dans le rapport entre capital engagé pour « honorer » les salaires et la valeur du travail fourni. Les nouvelles technologies et les rationalisations exigent chaque jour des travailleurs et de leurs syndicats des actions visant à en corriger leurs effets néfastes sur la santé et la « sécurité » de l’emploi, et de recommencer des négociations, de renforcer leur position dans le rapport de force.
L’âpreté des combats et les difficultés de l’économie tendent actuellement à dissuader certains de relever le défit, ou tout simplement de se défendre…
Cette tendance doit être jugulée et l’idéologie de nos adversaires combattue : leur profit n’est pas notre seule raison d’exister ; aussi il s’agit impulser un projet de société différent. Plus le syndicat sera capable d’expliquer les limites du syndicalisme dans le cadre du système, plus il saura trouver avec ses membres des solutions immédiates et des réponses viables aux problèmes concrets, de rallier à lui ceux qui hésitent.
Sur les lieux d’exploitation
La subordination des rapports sociaux de travail à l’économie autorise l’utilisation des nouvelles technologies pour renforcer les moyens d’exploitation, privant d’un poste de travail rémunéré un nombre de plus en plus importants de personnes.
La position syndicale qui vise à sauver les emplois de ceux qui ont encore une place ne peut pas rassurer sur leur devenir. Cette position a échoué puisque presque partout le nombre des salariés a diminué et diminue encore : travailleurs, délégués et responsables syndicaux se sont soumis – bon gré mal gré – à la notion « de ce qui est réalisable », mais ce faisant il n’est pas possible de protéger les travailleurs du développement de l’exploitation mondiale, ou de la concurrence que les Etats et les travailleurs se font internationalement entre eux.
Autrement dit : dans l’exacerbation générale, le consensus de l’histoire des rapports exploités-exploiteurs d’une entreprise, d’une région ou d’un secteur industriel disparaît, s’estompe. Les conditions de travail sont de plus en plus dures parce qu’elles entrent dans une contradiction de plus en plus violente avec les conditions du maintien et de l’accroissement du pouvoir du capital.
Il serait tout de suite possible de supprimer la rareté, mais cela n’est pas entrepris puisque c’est le moyen principal de coercition de toutes les civilisations qui nous ont précédé – et de celle d’aujourd’hui. Le travail, la production, deviennent en effet de plus en plus sociaux (au sens où leur organisation concerne et implique un nombre de plus en plus important de personnes et de connaissances) alors que le pouvoir de mettre en oeuvre ce travail, de distribuer cette production est détenu par un nombre de plus en plus petit de personnes pour qui les mots humanité, solidarité et démocratie ne signifient que désordre ou arrogance.
A chaque accord, les syndicalistes et les travailleurs peuvent mesurer l’insuffisance de la solution particulière dans le cadre de la vie en général.
A chaque conflit de travail, ils peuvent constater l’étendue de plus en plus vaste de la plaine sur laquelle devra se porter la bataille qui décidera du maintien du système des parasites, des gaspilleurs et des destructeurs de la planète, ou au contraire, du développement d’une organisation sociale différente avec pour principe central de « chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins ».
Le découragement se conjugue au présent
Là où les conditions de vie sont relativement satisfaisantes il y a aussi le sentiment que le système capitaliste pourvoit en général aux nécessités les plus impératives, et qu’à l’image de la réussite des plus « forts » ou des plus « brillants », il réussit à les combler de superflu. L’opinion que les choses pourraient s’améliorer lentement, progressivement, par étape, est régulièrement distillée par les média ; on voit une pléthore de biens et de services de toutes sortes…
Pourtant on peut voir également une société, ici, malade d’indigestion et plus loin misérable. L’excès de peines et la production de l’inutile, engendre le dégoût ou un sentiment de vide. Cela se traduit pour certains par un replis sur ses insatisfactions humaines en provoquant délabrement et angoisses, d’autres retournent la violence qui les traverse contre leurs proches ou eux-mêmes. La solitude se dessine dans presque toutes les têtes. L’absence d’espoir et de projet social provoque des comportements paniques, individualistes, suicidaires – et périodiquement xénophobes.
Si l’unanimité dans les syndicats se déclare encore pour dire qu’elle est résolue à marquer les limites à l’effronterie adverse et son appétit démesuré, elle n’a pas encore réussi à développer les moyens de devenir un contre-pouvoir constitué et incontournable par l’unité de sa composition.
Pour quoi lutter ?
A l’heure actuelle, la lutte pour le maintien des acquis est une bagarre dont rien ne laisse présager qu’elle sera gagnée par les travailleurs. Partiellement et par endroit, cela n’est pas impossible, mais ceux-là ne résisteront pas longtemps si le syndicalisme en général, et la politique en particulier, ne changent pas. En regardant autour nous, il y a urgence partout…
Nous pourrions invoquer les 35 heures ou la retraite à 60 ans, mais sans l’obtention d’un dispositif garantissant un emploi pour toutes et tous, rien ne sera résolu.
Donc d’une part, il s’agit d’imposer des solutions en matière de répartition équitable du travail salarié, et d’autre part de diminuer le rôle des rapports marchands comme forme d’organisation du travail et de la répartition de ses produits. Le droit de manger-assis-habillé-instruit doit être reconnu au même titre que le droit naturel de respirer, dormir ou d’aimer.
Une piste : le poste de travail appartient à tous
Jusqu’à présent, nous avons dit fort peu sur les engagements de personnel, nous nous sommes trop souvent limités à refuser les licenciements.
Aussi dans l’immédiat, nous devrions gagner le pouvoir de gérer et distribuer nous-mêmes les heures de travail. Si un employeur a besoin de 400 heures de travail par semaine, c’est aux travailleurs organisés, aux syndicats, de lui attribuer les personnes pour effectuer ces heures ; et d’offrir ainsi la possibilité à ceux qui veulent travailler 40 heures ou 30 ou 20 une semaine, puis 20 ou 30 ou 40 une autre.
Nous pourrions parer au mieux aux turpitudes de fin de carrière pour les anciens avec une réelle possibilité de retraite à la carte, ou offrir à celles et ceux qui sont intéressés des formations diverses et des occupations multiples. C’est ainsi également que nous pourrions le mieux combattre les a prioris et brimades patronales sur le poste de travail. Ce dernier perdrait le caractère privé et individuel imposé par le système actuel pour devenir une chose collective appartenant à toutes et tous.
une autre et complémentaire : la satisfaction des besoins sociaux
L’économie marchande est malade, elle a déjà exclu en 1992 plus 100000 personnes de l’opportunité d’un emploi salarié en Suisse, qui sont tributaires des prestations de chômage pour un terme, et condamnées à l’assistance au-delà.
Certains songent à imposer une réduction des heures de travail à ceux qui sont en emploi dans les entreprises privées ou les services d’Etat, à faire compenser la perte de salaire par la caisse de chômage et à engager du personnel pour effectuer les heures de travail ainsi libérées. C’est une forme de répartition du travail.
Pourtant il est des tâches sociales qui continueront d’être négligées, ou tout simplement ignorées comme elles l’ont été jusqu’à présent parce qu’elles ne dégagent pas de profit, ou qu’elles servent pas les besoins du capital.
Il en va ainsi du soin apporté aux anciens, aux invalides, d’une production agricole vraiment écologique, de l’entretien des rivières et des forêts ; ou encore de l’aide internationale aux sinistrés, en faveur de la paix, etc.
Ne pourrions-nous pas utiliser une partie des fonds destinés à prémunir les travailleurs contre les affres pécuniaires du chômage aux fins de créer les emplois nécessaires à la satisfaction de ces besoins sociaux reconnus, et d’offrir des emplois rémunérateurs à celles et ceux qui désirent les pourvoir ?
Il ne s’agirait bien sûr pas de développer une activité parallèle à celles existantes déjà sur le marché, mais plutôt de rétribuer par exemple les bénévoles s’occupant de cuisines scolaires, ou d’autres sociétés d’utilité sociale. On pallierait ainsi aux carences du système, et d’autre part on obtiendrait un droit au travail bien différent de l’esclavage et de l’abrutissement réservé à beaucoup d’entre nous dans les entreprises traditionnelles.
Conclusions
Nous avons besoin de créer des ponts entre l’économie actuelle avec les travailleurs qui y assument les tâches imparties, et une forme de société qui permette aux individus à se libérer du travail tel qu’il existe – tout en trouvant dans ce travail les moyens de s’y impliquer pour le transformer.
Claude Reymond, novembre 1992