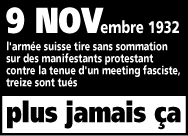à la mémoire du 9 novembre 1932, pour la démocratie et la liberté
p.a. CGAS - Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève
dans l’Illustré du 31-10
LE JOUR OÙ L’ARMÉE A TIRÉ
LE MASSACRE DE PLAINPALAIS
LE JOUR OÙ L’ARMÉE A TIRÉ
Fusillade du 9 novembre 1932. Il y a huitante ans, à Genève, des soldats ouvraient le feu sur des manifestants non armés. Treize morts et une centaine de blessés, le bilan est sans équivalent dans l’Europe démocratique des années 30. Retour sur un des épisodes les plus douloureux de l’histoire suisse, qui continue aujourd’hui encore à hanter les esprits.
Par Yan Pauchard - Mis en ligne le 31.10.2012
La nuit est tombée sur Genève en ce 9 novembre 1932. On n’y voit pas très bien. L’éclairage public aux alentours de la salle communale de Plainpalais est défectueux. Rassemblées contre le bâtiment, une centaine de recrues. Face à elles, quelque 200 personnes, en queue d’une manifestation organisée par le parti socialiste. Certaines veulent fraterniser avec les soldats, d’autres les invectivent. On leur lance du gravier ramassé par terre. C’est agité, mais personne ne peut imaginer le drame qui se prépare. Quand, soudain, à 21 h 34, cédant à la panique, le premier- lieutenant Raymond Burnat ordonne de tirer. Les armes crépitent. Si des militaires n’obtempèrent pas, d’autres font feu jusqu’à cinq, voire six reprises, en direction de la foule. Le fusil-mitrailleur tire 30 coups. En face, des corps s’écroulent, déchiquetés. La plupart sont de simples badauds. On comptera 13 morts et une centaine de blessés, un carnage sans équivalent dans l’Europe démocratique de ces années de crise.
L’onde de choc est d’autant plus grande que Genève accueille à ce moment-là une conférence sur le désarmement de la SDN. La presse internationale est présente sur les bords du Léman. The Economist dénonce une « boucherie inexcusable », alors que le Morning Post de Londres estime qu’une douzaine de policiers auraient suffi à calmer la situation. Un grand quotidien de Lisbonne se désole : « Le monde entier, écarquillant les yeux, demeure perplexe, sans bien comprendre (...) Le dernier paradis terrestre a perdu tout son prestige. » Mais comment une telle tragédie at- elle pu se dérouler à Genève, la « capitale de la paix » ? Pourquoi les soldats ont-ils tiré sans sommation audible, alors que leur intégrité physique n’était pas menacée ? C’est à ces questions qu’a tenté de répondre, à la veille du 80e anniversaire de ce funeste 9 novembre 1932, Jean Batou, professeur d’histoire internationale contemporaine à l’Université de Lausanne, qui consacre un imposant ouvrage, Quand l’esprit de Genève s’embrase, fruit de trois années de recherche.
« Genève sera fortement marquée par cet événement »
Claude Torracinta, journaliste, auteur d’un documentaire sur le sujet
« Un mois auparavant, à Fribourg, une manifestation beaucoup plus violente – une quasi-émeute avec des voitures de police incendiées – a été maîtrisée par les gendarmes et l’armée sans blessés graves. Alors pourquoi, à Genève, la situation a-t-elle dramatiquement dérapé ? » s’est demandé l’historien. Selon lui, ce n’est pas un hasard si cette fusillade s’est déroulée dans la Cité de Calvin. Ce n’est pas uniquement, comme on a pu le dire, la faute à des militaires mal préparés et paniqués. « Tout convergeait à cette tragique confrontation », assure Jean Batou. Pour comprendre, il faut se replonger en 1932. L’année, qui voit le monde s’inquiéter de la montée du nazisme en Allemagne, reste la période la plus dramatique de la grande dépression qui fait suite à la chute de Wall Street. La crise frappe de plein fouet la place financière genevoise. En juillet 1931, le scandale de la faillite de la Banque de Genève conduit à l’inculpation de plusieurs notables. Les établissements bancaires sont également mis sous pression par le gouvernement français d’Edouard Herriot, qui veut lutter contre l’évasion fiscale de ses riches concitoyens en Suisse.
« Les familles patriciennes genevoises alors au pouvoir sont aux abois », raconte Jean Batou. Elles se sentent de plus submergées par l’afflux de travailleurs fribourgeois, valaisans ou neuchâtelois. Des Confédérés alors considérés comme des étrangers, qui gonflent les rangs du parti socialiste genevois, à l’époque plus rouge vif que rose pâle. Emmené par le tribun Léon Nicole, le PS genevois connaît une progression fulgurante et menace de remporter les élections cantonales prévues en 1933. Pour la bonne société des beaux quartiers de la vieille-ville, la révolution bolchevique est à leurs portes.
L’ÉCOLE DE RECRUES DE LAUSANNE
La situation est donc explosive. Il suffira d’une étincelle. Celle-ci prendra la forme d’une réunion organisée le 9 novembre 1932 à la salle communale de Plainpalais par la toute jeune Union nationale, une formation d’extrême droite fascisante qui défilera bientôt en uniforme. Le parti socialiste décide de protester contre la tenue de ce meeting par une manifestation qui réunira vers 20 h 30 entre 5000 et 8000 personnes. Auparavant dans la journée, à midi, craignant des débordements, le président du Conseil d’Etat, Frédéric Martin, a obtenu de l’armée l’envoi de troupes pour prêter main-forte à la police. Mais le délai est court. Le Département militaire fédéral n’arrive à mobiliser que l’école de recrues de Lausanne. Les soldats – certains jugés peu sûrs sont mis de corvée de cuisine – arrivent en train à Cornavin dans l’après-midi et traversent la ville en fanfare. « Les autorités du canton n’ont pas voulu ces treize morts, analyse Jean Batou. Mais elles souhaitaient frapper un grand coup face aux socialistes et la situation leur a échappé. » Le déroulement des opérations sera en effet une succession d’erreurs : improvisation des officiers, choix tactiques incompréhensibles (les soldats traverseront la foule en file indienne), aveuglement du premier-lieutenant Raymond Burnat, futur membre d’Ordre et Tradition, le noyau dur de la Ligue vaudoise. « L’honneur de l’armée était en jeu », se justifiera-t-il plus tard, parlant de certaines de ses recrues qui s’étaient laissé désarmer par les manifestants. L’homme ne ressentira pas le moindre remords. « Enfermé dans ses certitudes, il est resté persuadé d’avoir eu raison, qu’une révolution se préparait à Genève », relève le journaliste Claude Torracinta, qui a interviewé Raymond Burnat pour un Temps présent en 1977.
LEADERS SOCIALISTES CONDAMNÉS
Au lendemain de la fusillade, le 10 novembre 1932, Genève se retrouve en état de siège. On craint la grève de protestation (elle sera suivie par près de 15 000 personnes) annoncée pour le 12 novembre, jour de l’enterrement des victimes. Huit bataillons sont mobilisés, les casernes fortifiées et des nids de mitrailleuses installés aux points névralgiques de la ville. Au matin, Léon Nicole est arrêté chez lui à la sortie du bain, un détail complaisamment divulgué pour discréditer le socialiste. A cette époque, posséder une baignoire est un luxe. Alors qu’aucune action pénale ne sera ouverte contre les officiers, les leaders socialistes sont condamnés pour obstruction aux ordres de l’autorité. La peine la plus lourde sera prononcée contre Léon Nicole : six mois de prison. Il en ressortira en héros. A peine libéré, le politicien est élu en novembre 1933 au Conseil d’Etat, avec trois autres socialistes. Genève devient alors le premier canton à majorité de gauche.
« Jusque dans les années 70-80, Genève sera fortement marquée par cet événement », constate Claude Torracinta, qui donna comme titre à son documentaire : Le temps des passions. Il faudra encore attendre le 9 novembre 1982, cinquante ans après les faits, pour que soit érigé un monument à la mémoire des victimes. Dessus, une épigraphe, qui résonne d’une manière particulière à l’heure de la crise économique où l’armée reparle d’intervenir dans la sécurité intérieure (lire encadré) : « Plus jamais ça. »
« Quand l’esprit de Genève s’embrase », Jean Batou, Edition d’en Bas, 483 p. (en librairie dès le 9 novembre).
« Un tel drame ne pourrait plus se reproduire aujourd’hui »
Denis Froidevaux, président de la Société suisse des officiers
Quel regard porte l’armée sur ce drame ?
La décision de faire appel à une troupe non aguerrie et non formée fut une grave faute de commandement. Et on n’utilise pas des armes contre une foule non armée. Ce fut un traumatisme d’autant plus grand qu’il s’agissait de miliciens : l’armée du peuple qui tire sur le peuple. L’émotion a été intense, elle hante toujours les esprits quand on parle de politique de sécurité. Pourtant tout a changé. Un tel drame ne pourrait plus se reproduire. L’armée n’intervient que sur le principe de subsidiarité, c’est-à-dire en soutien de la police (logistique, transport...) subordonnée aux autorités civiles. Ce fut le cas lors du G8, du Sommet de la francophonie ou chaque année lors du Forum de Davos. Les militaires n’ont aucun contact avec les manifestants.
Comment expliquer alors le projet controversé de créer une force de 1600 policiers militaires ?
Il faut être précis. Ce projet vise à former une réserve en vue d’appuyer les cantons. Ces hommes ne seront pas formés au maintien de l’ordre, mais à assister les forces de police dans des tâches annexes. On reproche à l’armée de travailler sur des scénarios de troubles inté-rieurs. Mais qui sait comment va se développer la crise en Europe ? Regardez les émeutes de Londres en 2011, qui ont viré en une quasi guerre civile.
titre documents joints
-
2012-10-31illustre_jour_armee_tire.pdf (PDF - 2.2 Mo)